No CrossRef data available.
Article contents
Jérémie Foa, Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy, Paris, La Découverte, 2021, 350 p.
Review products
Published online by Cambridge University Press: 26 April 2023
Abstract
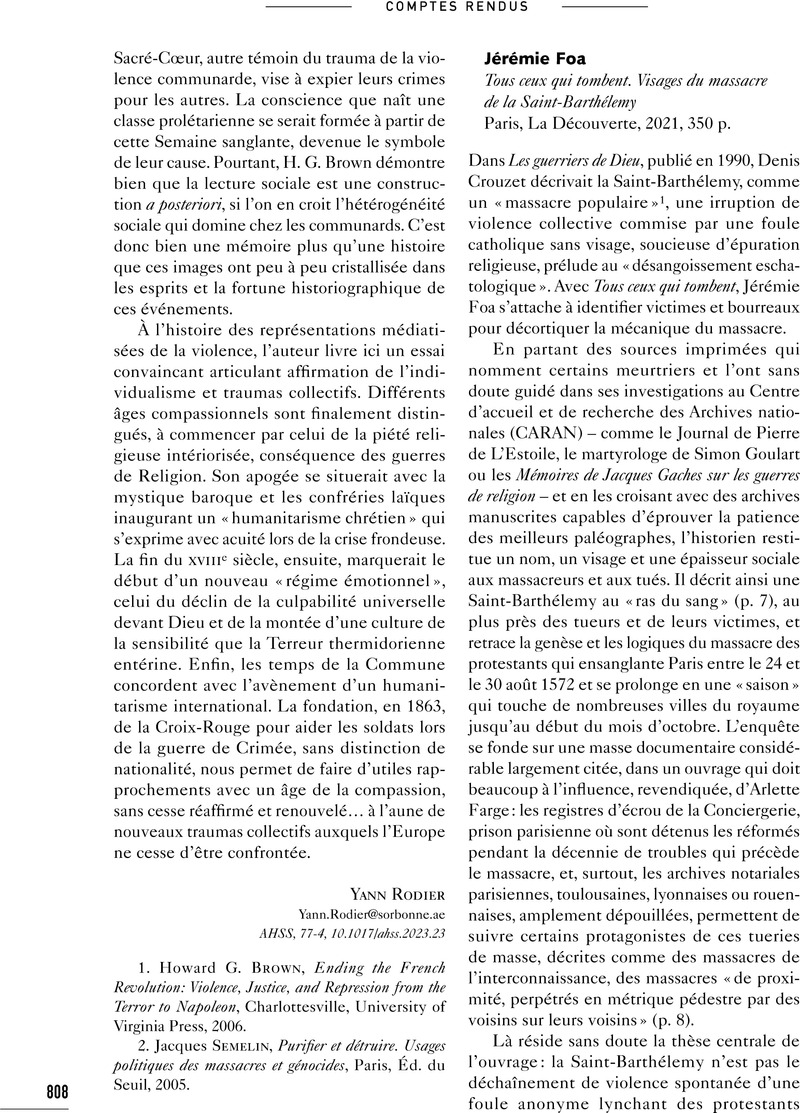
- Type
- Guerre et violences politiques (de l’Antiquité à l’âge des Révolutions) (comptes rendus)
- Information
- Copyright
- © Éditions de l’EHESS
References
1 Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion (vers 1525-vers 1610), Seyssel, Champ Vallon, 1990, vol. 2, p. 98.
2 Enzo Traverso, Passés singuliers. Le « je » dans l’écriture de l’histoire, Montréal, Lux éditeur, 2020.
3 Hélène Dumas, Le Génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, Éd. du Seuil, 2014 ; ead., Sans ciel ni terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006), Paris, La Découverte, 2021.
4 Christian Ingrao, Croire et détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS, Paris, Fayard, 2010, p. 13.


